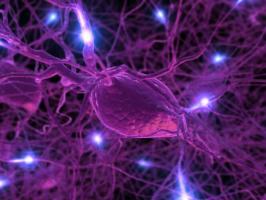Qu'est-ce que la neuroéthique (et quelles questions étudie-t-elle) ?
La neuroéthique est une partie de la bioéthique chargée d'étudier l'impact éthique, juridique et social des connaissances et recherches sur le cerveau, et des applications pratiques que celles-ci ont en médecine et, enfin, dans la vie des personnes.
Dans cet article, nous verrons plus en détail qu'est-ce que la neuroéthique, comment la recherche est menée dans cette discipline, quelles sont les grandes questions posées et leurs réponses, ainsi que les problèmes et les défis que l'avenir nous réserve.
- Article associé: "Quels problèmes la neuropsychologie traite-t-elle ?"
Qu'est-ce que la Neuroéthique ?
Le terme « neuroéthique » fait référence à la étude des questions éthiques, juridiques et sociales et des implications découlant des découvertes scientifiques impliquant la manipulation du cerveau à des fins médicales.
William Safire, journaliste lauréat du prix Pulitzer en 1978, a défini cette discipline comme "l'examen de ce qui est le bien et le mal, le bien et le mal, dans le traitement clinique et/ou chirurgical et dans la manipulation du cerveau humain".
Les avancées de la recherche dans le domaine des neurosciences impliquent une connaissance croissante des fondamentaux aspects neurobiologiques des questions liées à la conscience humaine, à la moralité, à la prise de décision ou au concept de « soi » et personnalité. Et en ce sens, la neuroéthique jouera un rôle décisif dans les années à venir.
Améliorations des méthodes de recherche en neuroimagerie, par exemple, nous permettent déjà de surveiller le fonctionnement du cerveau pratiquement en temps réel, afin que nous puissions "savoir" ce qu'il pense ou sent une personne, et même manipule ces pensées ou sentiments grâce à des techniques telles que la stimulation magnétique transcrânien.
Les avancées d'autres disciplines comme la psychopharmacologie ou la biochimie montrent déjà que la possibilité de manipuler un être humain, son état d'esprit ou ses capacités et capacités cognitives est déjà une réalité évident.
Et pour enrayer (ou pas) une future dystopie dans laquelle nous finissons par être des pantins télécommandés ou neuro-idiotés, la neuroéthique s'impose comme une discipline utile pour discuter des lois, des normes et des implications sociales qui émergent du bon ou du mauvais usage des neurotechnologies et des neurosciences.
- Vous etes peut etre intéressé: "Neurosciences cognitives: historique et méthodes d'étude"
Recherche scientifique en neuroéthique
La recherche scientifique en neuroscience de l'éthique ou neuroéthique s'est intéressée à deux aspects de celle-ci: l'empirique et le théorique. La neuroéthique empirique serait basée sur des données neuroscientifiques liées à des questions et des concepts éthiques, des données fondées sur l'expérience et la méthode scientifique, telles qu'elles sont conçues dans les sciences naturelles.
La neuroéthique théorique, quant à elle, porterait sur aspects méthodologiques et conceptuels qui servent à relier les faits neuroscientifiques avec des concepts éthiques, tant au niveau descriptif que normatif.
Les chercheurs trouvent le problème de ne pas avoir de corrélats qui, méthodologiquement, leur permettent d'explorer certains concepts d'un point de vue empirique, comme c'est le cas avec des termes tels que bonté, justice ou équité. Quels sont ses corrélats méthodologiques? SOIT... Quelle serait la conception techniquement adéquate pour pouvoir étudier ces concepts en neuroéthique ?
Un deuxième problème réside dans la partie théorique de la neuroéthique. Toute éthique ou morale aurait plusieurs fonctions: clarifier ce qu'on entend par « morale », tenter de découvrir quels sont ses fondements, et déterminer quels seraient les principes de ce qu'on appelle la morale, afin de les appliquer dans la société et dans la vie quotidien. Cependant, il n'est pas possible de partir uniquement des données neuroscientifiques pour clarifier ces doutes, puisque ce qui est considéré comme moral ne concerne pas seulement la science, mais aussi la philosophie.
Des questions comme, qu'entend-on par philosophie morale? ou quel type de réglementation serait nécessaire d'étudier en neurosciences?, sont quelques-uns de ceux qui ont intéressé de nombreux chercheurs, qui ont tenté de les résoudre de diverses manières. argumentation.
Réponses à comment faire des recherches en neuroéthique
Les réponses qui ont surgi à la question de savoir: quel type de conceptions techniquement appropriées doivent être réalisées pour enquêter sur la neuroéthique? ont pointé vers des études de la neuroimagerie fonctionnelle et ses principales techniques: électroencéphalographie quantitative, tomographie par émission de positrons, résonance magnétique fonctionnelle, tractographie et magnétoencéphalographie.
Ces techniques de neuroimagerie captent le cerveau en action et les chercheurs les interprètent en associant une activité (motrice, perceptive ou cognitive) avec l'image cérébrale produite, on peut donc en déduire que l'image indiquerait le réseau neuronal d'où provient ladite image cérébrale. activité; c'est-à-dire que le corrélat serait considéré comme une cause (neurodéterminisme).
Bien que ces types de techniques soient excellents pour explorer le système nerveux, il est quelque peu risqué de penser que l'on peut se fier uniquement aux résultats et aux données statistiques de ces tests tirer des conclusions unitaires sur des concepts et des questions aussi controversées que la morale ou le libre arbitre, par exemple.
En ce qui concerne la question de savoir comment la philosophie morale est comprise, il y a des auteurs tels que le docteur en psychologie Michael Gazzaniga qui proposent l'existence d'une éthique universelle, qui aurait une base neurobiologique spécifique et non philosophique. Pour sa part, le neuroscientifique Francisco Mora suppose que le concept d'éthique implique toujours la relation que nous avons avec les autres et estime que les différences entre l'éthique et la morale ne sont pas appropriées, puisque les deux termes sont utilisés indistinctement.
Enfin, face à la question de savoir quelle régulation serait nécessaire pour mener des recherches en neuroéthique, la réponse donnée par les chercheurs a été de faire appel à l'éthique des neurosciences; c'est-à-dire, recourir à l'éthique du travail effectué par les neuroscientifiques: la notion de capacité, l'expression libre et volontaire du consentement éclairé, le respect de la dignité et de l'intégrité des sujets de recherche, etc.
Problèmes et défis futurs
Les problèmes actuels de la neuroéthique peuvent être posés en deux grandes catégories: ceux liés aux avancées techniques des neurosciences, c'est-à-dire les implications du développement des techniques de neuroimagerie, de psychopharmacologie, d'implants cérébraux ou d'interface cerveau-machine; et ceux liés à la philosophie et à la compréhension des bases neurobiologiques de la conscience, de la personnalité ou du comportement humain.
Au cours des dernières années, la recherche psychopharmacologique a investi des sommes considérables dans les produits pharmaceutiques destiné au traitement des troubles cognitifs, et plus particulièrement des troubles de l'attention et de la mémoire. Médicaments tels que le méthylphénidate et son utilisation pour les troubles déficitaires de l'attention; ou l'ampakina, qui favorise les mécanismes de potentialisation à long terme, améliorant les performances des tests de mémoire chez les sujets sains, n'en sont que quelques exemples.
Ce augmentation de la consommation de drogue, notamment chez les sujets sains, soulève plusieurs questions éthiques telles que :
Problèmes de santé: les effets indésirables à moyen et long terme chez le sujet sain ne sont pas connus.
Conséquences sociales: des questions sont soulevées sur la façon dont l'utilisation de ces drogues pourrait affecter les relations ou dans quelle situation sont les individus qui n'en consomment pas, par rapport à ceux qui en consomment, en termes de classe ou inégalité. Et il semble clair que dans des contextes hautement concurrentiels et stressants, la liberté de ne pas les consommer serait relative.
Implications philosophiques: l'usage de ces médicaments remet en cause et altère la vision que l'on a de concepts tels que l'effort personnel, l'autonomie ou la capacité à s'améliorer. Est-il éthique d'améliorer rapidement et artificiellement les capacités cognitives ?
D'autre part, les avancées dans la compréhension des bases neurobiologiques du comportement social, de la morale ou de la prise de décision, ont des implications directes dans notre façon de concevoir les notions de notre vie, comme la responsabilité personnelle ou l'imputabilité d'une personne, aspects clés pour la neuroéthique.
À l'avenir, cette discipline continuera à discuter de questions pertinentes, telles que: peut-on juger un adolescent de la même manière pour un crime commis si l'on sait qu'à son âge les bases neurobiologiques du raisonnement moral ne sont pas encore installée? Si le libre arbitre n'est qu'une illusion cognitive et n'existe pas en tant que tel, est-il logique que les gens soient imputables? Devrions-nous mettre des barrières à la recherche et à la manipulation du cerveau? Des questions qui, encore aujourd'hui, n'ont pas de réponse claire.
Références bibliographiques:
- capot E Neuroéthique pratique. Bilbao: Desclée de Brouwer; 2010.
- Rideau, A. (2010): « Neuroéthique: les bases cérébrales d'une éthique universelle à pertinence politique? », in Isegoría, nº 42, 129-148.
- Farah M J. Neuroéthique: le pratique et le philosophique. Trends Cogn Sci 2005; 9 (1): 34-40.