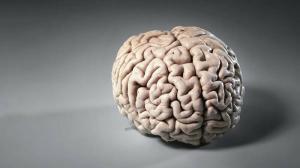Agnosie visuelle: incapacité à comprendre les stimuli visuels
Je m'étais arrêté chez un fleuriste sur le chemin de son appartement et j'avais acheté une rose rouge un peu extravagante pour ma boutonnière de revers. Je l'ai enlevé et je le lui ai donné. Il l'a pris comme un botaniste ou un morphologue à qui on donne un spécimen, pas comme une personne à qui on donne une fleur.
- « Environ six pouces de longueur. Une forme rouge roulée avec un ajout linéaire vert. "
-"Oui. Et qu'est-ce que tu penses être ?"
- « Ce n'est pas facile à dire. Il lui manque la symétrie simple des formes géométriques, bien qu'il puisse avoir sa propre symétrie supérieure... il pourrait s'agir d'une inflorescence ou d'une fleur "
P. il agissait exactement comme agit une machine. Ce n'était pas seulement qu'il montrait la même indifférence qu'un ordinateur envers le monde visuel mais qui a construit le monde comme un ordinateur le construit, à travers des caractéristiques et des relations distinctives schématique.
(...)
Je commence l'entrée d'aujourd'hui avec cet extrait d'un livre de
Oliver met à sac ("L'homme qui a pris sa femme pour un chapeau") dans lequel un cas de agnosie visuelle, qui conduit le protagoniste de l'histoire à une vision désintégrée du monde et à différentes situations qui, bien que comiques, entraînent un grave problème de reconnaissance visuelle.Agnosie visuelle: définition et explication
La vue étant notre sens principal, nous sommes toujours choqués et choqués par la lecture des modifications de quelque chose d'aussi basique que la perception. le cerveau, à travers sa fenêtre principale sur le monde –les yeux–, il nous montre une image simple et ordonnée du monde qui nous entoure.
Cette création faite par notre système nerveux est partagée, dans une mesure plus ou moins grande, par presque tout le monde. Les bases de tout ce que nous appelons réalité se trouvent dans la lumière qui frappe nos rétines et voyage à travers le nerf optique sous la forme d'une impulsion nerveuse, pour faire des synapses dans le noyau géniculé. du thalamus - une structure que nous pourrions considérer comme une sorte de péage cérébral dans lequel un grand nombre de synapses sont faites - jusqu'à ce que nous atteignions notre cortex visuel primaire dans le lobe occipital. Mais ce serait une erreur de croire que ce circuit, ces trois synapses, sont ce qui donne sens au monde dans lequel nous vivons. Ce qui nous empêche de vivre dans un monde chaotique ou fragmenté, comme dans le cas de P., c'est la fonction de la gnose.
Gnose, du latin savoir, fait référence à la capacité de reconnaître des objets, des personnes, des visages, des espaces, etc. De plus, c'est aussi la faculté qui nous offre une perception globale et solidaire de la réalité et non schématique ou « par parties ». Pourtant, l'agnosie visuelle est la perte de cette capacité. Pour mieux comprendre ce processus, nous parlerons des deux principales voies cérébrales qui participent à cette fonction. Nous parlerons également des types d'agnosie les plus fréquemment décrits dans la bibliographie.
Perception visuelle: le chemin de quoi et où
Comme nous l'avons dit, les informations de la rétine parviennent à notre cortex visuel primaire après avoir fait des synapses dans le thalamus. Mais le cortex visuel primaire n'est pas en lui-même informatif en matière de reconnaissance. Il ne traite que les caractéristiques physiques de ce que la rétine perçoit. C'est-à-dire: la lumière, le contraste, le champ visuel, l'acuité visuelle, etc.
Ainsi, le cortex visuel primaire, l'aire 17 de Brodman, ne possède que des informations brutes. Cela ne nous dit pas que nous voyons un beau coucher de soleil ou une feuille sèche. Ensuite, Que faut-il pour reconnaître un objet ?
Reconnaître des objets, des visages, des lieux...
En premier lieu, nous devons être capables de voir l'objet en question, en faisant ces trois synapses avec afin de capturer les informations physiques de la lumière qui frappe d'abord l'objet, puis notre rétine. En second lieu, il faut intégrer toutes ces informations pour les percevoir comme un tout. Enfin, nous devrons sauver de notre Mémoire la mémoire de cet objet déjà présent dans nos mémoires et son nom.
Comme on le voit, cela implique plus d'une source d'information. Dans le cerveau, le cortex chargé de relier différents types d'informations est appelé cortex associatif. Pour effectuer les étapes que nous avons décrites, nous aurons besoin d'un cortex associatif. Le cerveau aura donc besoin de plus de synapses, et c'est là que les voies quoi et où entrent en jeu.
1. identifiant
La voie quoi, ou voie ventrale, est dirigée vers le lobe temporal et est responsable de la reconnaissance et de l'identification des objets. C'est ainsi que, si par exemple nous voyons au milieu du désert une chose verte, grosse et épineuse, nous aide à l'identifier comme un cactus et non comme Hulk.
Il n'est pas surprenant que cette voie soit localisée dans le lobe temporal si l'on pense qu'il s'agit de la principale en charge des fonctions mémorielles. C'est pourquoi la voie de Quoi Ce sont des projections nerveuses qui relient les informations de notre rétine à celles de notre mémoire. C'est la synthèse des informations optiques et limbiques.
2. Emplacement
Le moyen de où, ou via dorsale, se projette vers le lobe pariétal. C'est le moyen responsable de la localisation des objets dans l'espace; percevoir leur mouvement et leur trajectoire, et relier leur emplacement les uns aux autres. C'est donc la manière qui nous permet de diriger efficacement nos mouvements dans un espace donné.
Ce sont les neurones qui nous permettent de suivre des yeux la direction prise par une balle de tennis qui passe d'un terrain à l'autre. C'est aussi le moyen qui nous permet d'envoyer une lettre à une boîte aux lettres sans faire d'erreurs.
Différents troubles neurologiques –infarctus, traumatismes crâniens, infections, tumeurs, etc.– peuvent affecter ces voies avec les déficits attendus selon la région touchée. Comme d'habitude, ces régions cérébrales ne seront pas seulement affectées si leur cortex est endommagé, mais aussi si les fibres qui relient ces zones au cortex visuel sont touchées primaire.

Agnosie visuelle aperceptive
Dans ce type d'agnosie composants de la perception échouent, et par conséquent, il n'y a pas de reconnaissance. La perception est la faculté qui intègre les caractéristiques physiques d'un objet afin que nous puissions les saisir comme un tout tridimensionnel.
Dans l'agnosie visuelle aperceptive, cette intégration est fortement altérée et le patient présente des déficits même dans la reconnaissance des formes les plus simples. Ces patients, confrontés au dessin d'un marteau, ne sauront pas le reconnaître comme un marteau. Ils ne sauront pas non plus comment le copier ou le faire correspondre avec un autre dessin du même marteau. Malgré tout, l'acuité visuelle est normale, ainsi que la perception de la lumière, de l'obscurité, etc. En fait, les patients peuvent même éviter les obstacles en marchant. Cependant, les conséquences pour le patient sont si graves que fonctionnellement, ils ont tendance à être presque aveugles avec de graves problèmes d'indépendance.
Certains auteurs, de manière très opportune, ont paraphrasé Saramago « il y a des aveugles qui ne peuvent pas voir, et des aveugles qui voient ils ne peuvent pas voir ». Le cas d'un patient atteint d'agnosie aperceptive serait le second. Ces patients peuvent reconnaître l'objet par une autre modalité sensorielle telle que le toucher - parfois en touchant les différentes parties de l'objet en question - ou avec des indices contextuels ou des descriptions du examinateur. De plus, ces types d'actions de l'examinateur aident à faire un diagnostic différentiel et à exclure que l'anomie - incapacité à dire le nom de ce qui est vu - n'est pas due à un déficit du langage, par exemple.
C'est un type rare d'agnosie et a été décrit plus fréquemment après des infarctus bilatéraux des régions de la artères postérieures, intoxication au monoxyde de carbone et dans la variante postérieure de la maladie d'Alzheimer. Donc, il est produit par des pathologies qui affectent les régions occipitotemporales.
Agnosie visuelle associative
Dans ce type d'agnosie, en plus de l'acuité visuelle, la perception de la couleur, de la lumière, du contraste... la perception est également préservée. Cependant, malgré une perception normale, la reconnaissance est affectée. Comme dans le cas précédent, avant le dessin d'un marteau, le sujet ne saura pas qu'il s'agit d'un marteau, mais dans ce cas il pourra l'assortir à un autre dessin de marteau. Vous pouvez même copier le dessin ou décrire l'objet.
Ils peuvent identifier le dessin grâce à l'un des détails de l'objet représenté. En règle générale, les objets sont plus difficiles à identifier que les vrais, peut-être en raison d'un facteur contextuel. Encore une fois, le reste des modalités sensorielles peut aider à sa reconnaissance.
Agnosie associative semble être dû à la déconnexion entre les systèmes visuel et limbique. Le substrat peut être la lésion bilatérale de la substance blanche (fascicule longitudinal inférieur) du cortex associatif occipital au lobe temporal médial, ce qui implique une déconnexion des systèmes visuels et Mémoire. C'est pourquoi cette agnosie est aussi appelée agnosie amnésique. Les causes sont similaires au cas de l'agnosie aperceptive.
Autres types d'agnosie
Il existe de nombreux autres types d'agnosie et de troubles de la perception. Ci-dessous, j'en citerai quelques-uns. Je vais juste faire une petite définition pour identifier le trouble,
1. Achromatopsie
C'est l'incapacité de distinguer les couleurs. Les patients qui en souffrent voient le monde en nuances de gris. Une lésion bilatérale de la région occipitotemporale apparaît secondairement. Il y a très peu de cas enregistrés. Si la blessure est unilatérale, elle ne provoquera pas de symptômes. Je recommande fortement la lecture "Anthropologue sur Mars« Dans lequel l'histoire d'un cas d'achromatopsie est racontée. Aussi, lire Oliver Sacks est toujours un plaisir. Je vous montre un fragment dudit cas qui sera beaucoup plus explicatif du trouble que ma définition :
"Monsieur I. Elle pouvait à peine supporter l'apparence des gens maintenant ("comme des statues grises animées"), et sa propre apparence dans le miroir non plus: elle évitait vie sociale, et les relations sexuelles lui semblaient impossibles: il voyait la chair des gens, la chair de sa femme, sa propre chair, d'un gris abominable; la "couleur chair" lui semblait "couleur rat" [.. .] Il trouvait la nourriture désagréable en raison de son aspect terne et grisâtre et devait fermer les yeux pour manger.
2. Prosopagnosie
C'est l'incapacité de reconnaître les visages de proches, de personnes célèbres déjà connues ou même le visage de soi dans le miroir.
La prosopagnosie il s'agit d'un déficit spécifique de reconnaissance faciale et, par conséquent, nous devons exclure d'autres types d'agnosie pour son diagnostic. En général, les autres fonctions telles que la lecture ne sont pas affectées.
Ils peuvent également estimer s'il s'agit de visages humains ou de primates et même reconnaître l'expression émotionnelle du visage en question. Il est à noter que les déficits sont plus évidents lorsque les photographies sont reconnues que lorsque la personne en question est vue, puisqu'il y aura d'autres indices contextuels comme leur mouvement. Aussi très intéressante est la proposition de Damasio et al (1990) qui considéreraient que la prosopagnosie ne serait pas tant un échec dans la reconnaissance faciale, mais plutôt l'incapacité d'identifier l'individualité au sein d'un ensemble de Similaire.
3. Acinétopsie
C'est l'incapacité de percevoir les objets en mouvement. Elle est fréquemment due à des lésions occipito-pariétales postérieures. Le premier cas d'acinétopsie a été décrit en 1983 chez une femme de 43 ans qui avait subi plusieurs infarctus cérébrovasculaires bilatéraux. Les déficits ont sérieusement affecté leur niveau d'indépendance. Par exemple, il avait besoin de toucher le bord de la tasse pour savoir quand verser le café.
Quelques conclusions
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de justifier à quel point la fonction de la gnose est fondamentale pour nos vies. D'une certaine façon, notre conscience dépend de ce que nous voyons et de la réalité qui compose notre cerveau. Cette "réalité", fabriquée par nos circuits, est peut-être loin de ce qu'est la réalité en tant que telle. Réfléchissons un instant: quand nous voyons comment quelqu'un parle, généralement ce que nous voyons et ce que nous entendons a une synchronicité. C'est-à-dire que si un ami nous parle, nous ne devrions pas voir qu'il bouge d'abord sa bouche et ensuite nous écoutons le son, comme s'il s'agissait d'un film mal doublé. Mais, d'un autre côté, la vitesse de la lumière et la vitesse du son sont très différentes.
Le cerveau, en quelque sorte, intègre la réalité pour que nous la comprenions de manière ordonnée et logique. Lorsque ce génie cartésien maléfique échoue, le monde peut prendre un ton chaotique et aberrant. Comme le monde fragmenté de P. ou le monde absent de couleur de I. Mais leur monde est-il plus irréel que le nôtre? Je ne pense pas, nous vivons tous en quelque sorte trompés par notre cerveau. Comme si nous étions dans la matrice. Une matrice créée par nous-mêmes.
Des patients comme P. J'ai entendu. Ils ont contracté des pathologies qui les ont éloignés de la « réalité » que nous avons l'habitude de partager avec d'autres êtres humains. Bien que ces cas spécifiques aient eu des fins heureuses caractérisées par l'amélioration de soi, dans la veine habituelle d'Oliver Sacks, il convient de noter que tous les cas ne sont pas aussi beaux. Les neurologues et neuropsychologues ne voient que des manifestations cliniques de ces pathologies et, par conséquent, Malheureusement, à maintes reprises, face à ces cas, nous sommes obligés d'adopter une attitude de "voyeur". C'est-à-dire, plusieurs fois, nous ne pouvons pas faire beaucoup plus que de suivre le cas et de voir comment il évolue.
Actuellement, les thérapies pharmacologiques pour les troubles neurodégénératifs sont d'une utilisation très limitée. La science doit développer de nouveaux médicaments. Mais les neuropsychologues doivent développer de nouvelles thérapies non pharmacologiques au-delà de la stimulation cognitive classique. En cela, des centres tels que l'Institut Guttmann, spécialistes de la neuroréadaptation, font un grand effort et un grand dévouement. Mon opinion subjective est que les nouvelles thérapies de réalité virtuelle marqueront peut-être le 21e siècle de la neuropsychologie. Dans tous les cas, nous devons travailler sur cette option ou sur d'autres et ne pas nous contenter du diagnostic.
- Texte corrigé et édité par Frédéric Muniente Peix
Références bibliographiques:
Des livres dans lesquels des cas d'Agnosie sont racontés et je recommande fortement de les lire :
- Luriia, A., Lemos Giráldez, S., & Fernández-Valdés Roig-Gironella, J. (2010). Monde perdu et récupéré. Oviedo: Krk Ediciones.
- Sacs, O. (2010). L'homme qui a pris sa femme pour un chapeau. Barcelone: Anagramme.
- Sacs, O. Un anthropologue sur Mars. Barcelone: Anagramme
Manuels :
- Arnedo A, Bembire J, Tiviño M (2012). Neuropsychologie à travers des cas cliniques. Madrid: Éditorial Médica Panamericana.
- Junqué C (2014). Manuel de neuropsychologie. Barcelone: Synthèse
Des articles:
- lvarez, R. & Masjuan, J. (2016). Agnosies visuelles. Revista Clínica Española, 216 (2), 85-91. http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2015.07.009
Je recommande fortement cet article ci-dessus. C'est très bien expliqué et c'est très clair et concis.
- Barton, J. (1998). Fonction visuelle corticale supérieure. Opinion actuelle en ophtalmologie, 9 (6), 40-45. http://dx.doi.org/10.1097/00055735-199812000-00007
- Barton, J., Hanif, H., & Ashraf, S. (2009). Relation des connaissances sémantiques visuelles et verbales: l'évaluation de la reconnaissance d'objets dans la prosopagnosie. Cerveau, 132 (12), 3456-3466. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awp252
- Bouvier, S. (2005). Déficits comportementaux et loci de dommages corticaux dans l'achromatopsie cérébrale. Cortex cérébral, 16 (2), 183-191. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhi096
- Naccache, L. (2015). La conscience visuelle expliquée par ses déficiences. Opinion actuelle en neurologie, 28 (1), 45-50. http://dx.doi.org/10.1097/wco.0000000000000158
- Riddoch, M. (1990). M.J. Farah, Agnosie visuelle: Troubles de la reconnaissance des objets et ce qu'ils nous disent de la vision normale. Psychologie biologique, 31 (3), 299-303. http://dx.doi.org/10.1016/0301-0511(90)90068-8
- Zeki, S. (1991). Akinétopsie cérébrale Un examen. Cerveau, 114 (4), 2021-2021. http://dx.doi.org/10.1093/brain/114.4.2021